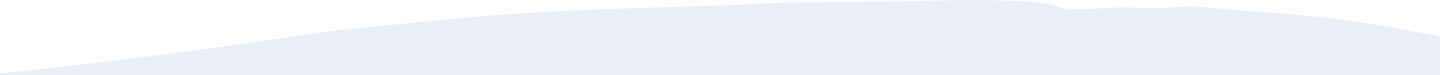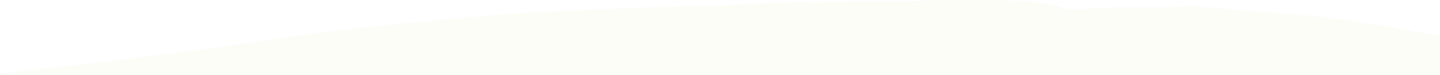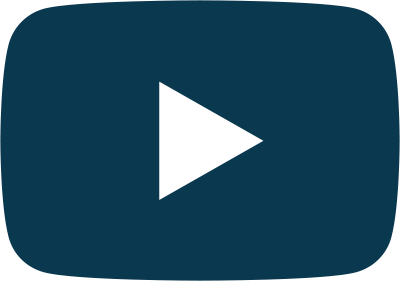Troubles psychiques et parentalité : éviter la surprotection, réapprendre la liberté
Protéger son enfant, c’est un réflexe. On veut qu’il aille bien, qu’il se sente aimé, entouré, stimulé. On s’inquiète quand quelque chose ne va pas, on essaie de tout faire pour l’aider. Mais quand les troubles psychiques viennent perturber l’équilibre, il devient facile d’en faire trop, sans même s’en rendre compte. On veut éviter qu’il se sente à part, qu’il souffre du regard des autres ou du manque de lien social. On cherche à le rassurer, à tout prix. Pour beaucoup de parents, c’est là que commence une sorte d’équilibre fragile : comment préserver son enfant sans le surprotéger ? Comment l’accompagner en lui laissant suffisamment d’espace pour qu’il réussisse à s’accomplir ? Pour mieux comprendre ce que vivent les familles au jour le jour, Plein Espoir a rencontré Frédéric, père d’une adolescente haut potentiel, touchée par un trouble borderline et des troubles alimentaires, et Carole, maman d’une jeune adulte qui vit avec un trouble schizophrénique
Marie a toujours été une enfant différente. À cinq ans, elle avait déjà sauté deux classes. Elle s’ennuyait en cours, apprenait vite, mais restait seule. Première de la classe, oui, mais mise à l’écart par les autres enfants. « Contrairement à ses sœurs, elle n’a jamais été invitée à un anniversaire », nous raconte Frédéric, son père. Alors, avec son ex-compagne, ils ont essayé de compenser. Ils étaient très présents, faisaient beaucoup d’activités avec elle, pendant que les deux autres filles jouaient avec leurs amis. À l’adolescence, elle est victime de harcèlement. « À la fin du collège, elle a commencé à être harcelée. Elle ne nous disait rien, mais un jour, ma femme a vu qu’elle se scarifiait les cuisses. Elle nous a montré les messages », nous confie-t-il. Frédéric l’emmène consulter plusieurs spécialistes. Mais face aux médecins, Marie masque tout. Elle sourit, minimise, joue le jeu. Les semaines passent, puis une nuit, la plus jeune de ses sœurs la retrouve inconsciente dans la salle de bain, les bras en sang. Marie est hospitalisée plusieurs mois dans un service psychiatrique pour enfants. « Au début, on ne pouvait pas la voir. Puis, après quelques semaines, on a eu le droit de passer juste quelques heures avec elle. »
Protéger à tout prix
Depuis sa chambre d’hôpital, l’adolescente commence à demander à ses parents d’apporter certains objets, de lui acheter des choses qui lui font plaisir. Aussi, elle devient très sélective sur ce qu’elle accepte de manger. Avant, elle goûtait à tout, sans vraiment faire d’histoire. Désormais, seuls quelques aliments trouvent grâce à ses yeux. « Quand ton enfant a frôlé la mort, même si tu ne sais pas vraiment si c’était un appel à l’aide ou une vraie volonté de partir, tout s’effondre et tu passes tous ses caprices, raconte Frédérique, la voix posée. Tu n’arrêtes pas de te demander ce que tu n’as pas vu, ce que tu aurais pu faire autrement. Tu te dis que c’est de ta faute. Et tout ce qui comptait avant – ton boulot, tes amis, ta vie de couple – passe au second plan. Il ne reste que ça : la peur qu’elle replonge. Et ce besoin de la voir tenir debout. » Quand Marie obtient l’autorisation de rentrer une journée en famille, la maison se transforme en zone sous haute surveillance. Frédéric cache tout ce qui pourrait blesser : les ciseaux, les couteaux, même les objets les plus anodins sont rangés hors de vue. Marie dit qu’elle étouffe un peu. Qu’elle aimerait avoir un peu d’air. Mais pour ses parents, détourner le regard, ne serait-ce qu’une seconde, est impossible.
Pour Carole, la situation est un peu différente. Sa fille a commencé à avoir des problèmes quand elle est partie du cocon familial pour faire ses études. « Léa a rapidement perdu le lien avec ses amis d’enfance, elle ne s’en est pas fait de nouveaux. Quand elle rentrait le week-end, je la trouvais changée. Elle avait pris du poids, ses cheveux n’étaient pas toujours propres, elle restait enfermée. Et puis… à vingt ans, normalement, on a envie de sortir, de faire la fête non ? », nous dit Carole, d’une voix douce. La mère de famille pense d’abord à une petite déprime passagère, comme tant d’autres à cet âge. Elle ne s’imagine pas qu’il puisse s’agir de quelque chose de plus profond. Jusqu’à ce jour, quelques mois plus tard, où tout bascule. Alors qu’elle est en vacances avec son mari, son téléphone sonne. Les gendarmes lui expliquent que sa fille, après une fête de famille, n’est pas rentrée chez elle. Elle a été retrouvée à errer dans un village sans savoir où elle se trouvait. Mais surtout, elle n’arrive plus à distinguer ce qui est réel de ce qui ne l’est pas. Carole et son compagnon font plus de 500 kilomètres pour la rejoindre. « Quand Léa a été conduite à l’hôpital, les médecins lui ont donné un anxiolytique. Elle s’est sentie un peu mieux, plus calme », raconte Carole. Sa fille lui a demandé de rentrer à la maison. De retour dans le foyer familial, Carole pousse sa fille à venir manger à table, à reprendre un rythme normal, à dormir la nuit comme avant. Elle essaie de recréer un cadre, de remettre un peu d’ordre, comme si cela pouvait suffire à ramener sa fille à elle. Elle ne sait pas encore qu’elle est dans une réalité qui lui échappe et qu’il faut lui laisser de l’espace. Très vite, son état se dégrade. Léa est envahie par des angoisses de mort difficiles à apaiser.
Quatre mois plus tard, alors qu’elle est suivie en hôpital de jour, le diagnostic de schizophrénie est posé. Par chance, Carole trouve la formation Profamille, un programme de psychoéducation destiné aux proches de personnes vivant avec des troubles psychiques. « Au début, je culpabilisais beaucoup. Je me disais que je n’avais pas vu les signes assez tôt. Et cette question me hantait : qu’est-ce qu’elle fera quand on ne sera plus là ? » La formation lui permet de trouver des outils concrets pour mieux comprendre, mieux réagir en cas de crise, maintenir le lien sans se perdre. « On m’a expliqué que ce n’était pas de ma faute. Que c’était une maladie du cerveau. Et ça, ça change tout. On m’a redonné une forme de pouvoir d’agir. J’ai compris qu’il fallait que j’arrête de vouloir tout le temps la prendre dans mes bras quand elle n’allait pas bien, que je lui laisse de l’espace. »

Faire confiance à nouveau, pas à pas
Quand Marie sort de l'hôpital, Frédéric et sa compagne ne sont pas d’accord sur la manière d’accompagner son retour. Lui pense qu’il faut réintroduire peu à peu des repères, des habitudes. Elle, de son côté, redoute que la moindre contrariété ne provoque une rechute. Alors, elle cède à tout, sans oser dire non. Mais dans cette maison où chacun marche sur des œufs, ce sont les petits gestes du quotidien qui vont doucement refaire surface. Frédéric commence par demander à sa fille de mettre la table. Ce n’est pas grand-chose, juste une assiette, une fourchette. Puis, elle doit sortir le chien. Le matin, il l’encourage à se lever à heure fixe, même si c’est plus tard que ses sœurs, juste pour redonner un rythme. Parfois, elle proteste. D’autres fois, elle s’exécute, en traînant un peu, mais sans s’effondrer.
« Ce n’était jamais dans la confrontation. C’était toujours par petites touches, pour qu’elle sente qu’elle était capable », explique Frédéric. Peu à peu, Marie reprend des choses qu’elle avait abandonnées : ranger sa chambre, préparer son petit-déjeuner seule, se laver sans qu’on le lui rappelle. Sa mère observe, d’abord inquiète. « Elle avait peur que la moindre contrariété la brise à nouveau. Mais elle a vu que ces petites contraintes, en réalité, l'aidaientt à se reconstruire. Qu’elle avait besoin de ça pour redevenir elle-même », explique Frédéric. La mère lâche un peu. Elle recommence à poser des limites, à faire confiance aussi, là où il n’y avait que la peur. Marie, de son côté, comprend que ces règles ne sont pas des punitions, mais des ancrages. Et, un jour, elle évoque l’idée de reprendre ses études, à son rythme. La maison n’est plus verrouillée, mais elle n’est plus sans cadre non plus.
Avec le recul, Frédéric mesure à quel point poser un cadre a été déterminant. « Si on avait continué à tout faire pour elle, à la ménager sans arrêt, elle aurait eu du mal à progresser. Elle aurait gardé cette idée qu’elle ne peut pas. Qu’elle a besoin de nous pour chaque chose. » Le choix n’a pas été simple. Il a fallu accepter de prendre des risques, de laisser une part d’inconnu entrer dans leur quotidien. Mais c’est justement cette prise de distance qui a permis à Marie de se réapproprier sa vie, à son rythme. « Bien sûr qu’on a encore peur, qu’on se demande si on verra les signes à temps si quelque chose ne va pas. Mais on ne peut pas l’empêcher de faire ses propres expériences, d’apprendre de ses erreurs, de se confronter aux difficultés. Parce que c’est ça, la vie aussi », dit Frédéric. Il sait que la vigilance ne disparaîtra jamais tout à fait. Que leur regard restera plus attentif, plus inquiet parfois, que pour ses sœurs. « Être tout le temps derrière elle, ce n’est pas lui rendre service. Il faut qu’elle sente qu’on croit en elle. C’est ça qui fait tenir, au fond. Pas la peur, mais la confiance. » Le rétablissement, dans leur famille, a pris la forme d’un pas de côté. Savoir s’éloigner un peu, pour qu’elle puisse avancer seule.
De son côté, Carole apprend une forme de patience qu’elle ne soupçonnait pas. Une vigilance silencieuse, sans contrôle permanent, sans surinterprétation. Elle comprend qu’elle aussi qu’il faut parfois s’effacer un peu, laisser de l’espace, même quand l’angoisse incite à resserrer l’étreinte. Le plus complexe, parfois, c’est que sa fille est adulte. « Une fois, elle m’a dit : maman, je suis majeure et je sens que je suis allée trop loin. C’est là qu’on voit qu’il y a encore un fil, un lien de confiance. » Depuis, elle a trouvé un traitement qui lui convient. Peu à peu, son équilibre s’est stabilisé, et avec lui, une nouvelle forme d’autonomie a émergé. Elle fait les choses à son rythme, mais elle les fait. Cela fait sept mois que la jeune femme ne vit plus chez ses parents. Ce départ, ils l’ont préparé ensemble, pas à pas. Et il a fallu, aussi, que Carole soit prête à ce mouvement-là. « Elle n’est pas loin. Et elle gère très bien. Les papiers, le ménage, le quotidien. Quand quelque chose bloque, on lui montre, on l’accompagne. Mais c’est elle qui fait. » Pour Léa, ce changement est un tournant. Pour ses parents aussi. Cela donne une image positive, une forme de confiance réciproque. Et ça leur permet de retrouver, eux aussi, un peu d’espace dans leur couple, dans leur vie. Socialement, la jeune femme reste très isolée. Pas d’amis de son âge. Ses parents sont ses principaux repères. Cette place, Carole l’assume, mais elle sait qu’il faut veiller à ne pas tout faire à sa place. « Il y a des moments où je me surprends à vouloir la préserver de tout. Elle me demande quelque chose, je dis non, puis je finis par le faire quand même, parce que ça m’inquiète. » Mettre des limites reste un travail constant. Savoir dire : “ça, ce n’est pas pour tout de suite”. Résister à la tentation de compenser la maladie par des petits plaisirs immédiats. Carole et son mari savent qu’il peut y avoir d’autres crises, d’autres hospitalisations. Ils ont appris à vivre avec cette incertitude, à apprivoiser la vie telle qu’elle est, et non telle qu’ils l’avaient imaginée. Et surtout, à marcher à ses côtés, sans chercher à la guider tout le temps. Avec doigté. Avec amour. Avec cette part de flou qu’on ne maîtrise jamais vraiment.
Vous souhaitez en savoir plus et rencontrer d’autres personnes engagées dans le rétablissement ? Rejoignez les réseaux sociaux de Plein Espoir, le média participatif dédié au rétablissement, créé par et pour les personnes vivant avec un trouble psychique.
Cet espace inclusif est une initiative collaborative ouverte à toutes et tous : personnes concernées, proches, et professionnels de l’accompagnement. Vos idées, témoignages, et propositions sont les bienvenus pour enrichir cette aventure. Contribuons ensemble à bâtir une société plus éclairée et inclusive.