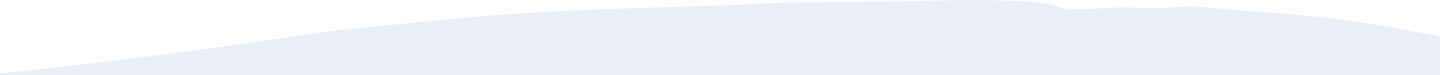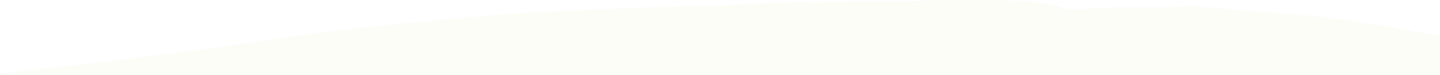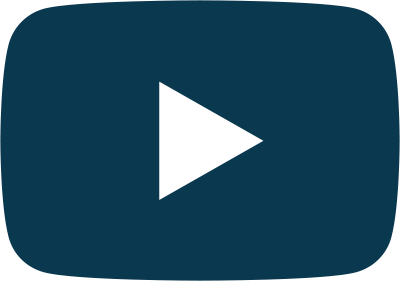Psychiatrie et rétablissement : faire vivre les droits des personnes concernées
Et si on voyait le droit non pas comme quelque chose de compliqué, mais comme une protection concrète, qui peut vraiment changer la vie de quelqu’un ? C’est ça, le droit des personnes concernées par les soins psychiatriques. Un droit encore trop peu connu, parfois mis de côté, alors qu’il est essentiel. Parce qu’il ne parle pas que de lois, il parle de respect et de dignité. Il dit qu’une personne hospitalisée sans son consentement garde des droits. Le droit d’être informé, de faire appel, de contester une décision. Le droit aussi de demander un autre médecin, ou d’être soignée ailleurs. Mais dans la réalité, ces droits sont souvent difficiles à faire valoir. Pour mieux comprendre ce que cela recouvre — dans la pratique et sur le terrain — Plein Espoir a rencontré maître Raphaël Mayet, bâtonnier du barreau de Versailles et spécialiste des soins sans consentement. Il nous raconte comment le droit a évolué, ce qu’il permet déjà, et surtout le chemin qu’il reste à parcourir pour qu’il soit pleinement respecté.
Plein Espoir : On parle souvent de soins ou de contraintes en psychiatrie, mais rarement des droits des patients. Où en est-on aujourd’hui ?
Raphaël Mayet : Les droits des patients ont beaucoup changé ces dernières années, aussi bien sur le fond des mesures que sur ce qui se joue concrètement dans leur application. On le voit particulièrement sur les mesures d’isolement et de contention. Aujourd’hui, la loi encadre ces pratiques. Une mesure d’isolement ne peut excéder douze heures, renouvelables dans les mêmes conditions, par tranches de douze heures, dans la limite de quarante-huit heures. Autrefois peu contrôlées, ces décisions font maintenant l’objet d’un encadrement beaucoup plus strict. Prenons un exemple concret : dans le département des Yvelines, la contention a quasiment disparu. Chaque année, sous l’impulsion des avocats, près de 27 % des mesures d’isolement ou de contention sont levées.
Cela fait partie d’un mouvement plus large : celui d’une ouverture progressive de la psychiatrie. On sort petit à petit de l’isolement dans lequel elle a longtemps été tenue. Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. Et pour être honnête, je ne suis pas sûr de voir un jour ce changement pleinement abouti. Mais la dynamique est là. Il faut se rappeler ce qu’était l'asile autrefois : un lieu souvent situé en dehors des villes. Des murs hauts, des grilles épaisses, pensés pour cacher, pour couper les personnes concernées de la vie en société. La psychiatrie échappait au regard… et donc, au droit. Après, il faut toujours aller plus loin et construire un vrai droit en psychiatrie, qui respecte à la fois le soin, la liberté et la place des personnes concernées. Un droit qui les reconnaisse comme des sujets à part entière, pas juste comme des cas à traiter.
Plein Espoir : Dans votre pratique, quels sont les cas que vous voyez le plus souvent ?
Raphaël Mayet : Je suis sollicité pour plusieurs types de situations. Il y a des personnes actuellement hospitalisées sans leur consentement qui veulent faire lever cette mesure. Et puis il y a des dossiers plus anciens : des personnes qui ont été hospitalisées par le passé, qui demandent aujourd’hui à consulter leur dossier médical, et qui cherchent à comprendre ce qui s’est passé. Parfois pour faire reconnaître un abus ou simplement mettre des mots sur une période difficile. C’est souvent une démarche de vérité, ou de réparation.
Plein Espoir : Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez aujourd’hui ?
Raphaël Mayet : Une des grandes limites, c’est le rôle du juge. Il a deux missions : vérifier si la mesure de soins sans consentement est justifiée, et contrôler ce qui se passe pendant cette hospitalisation, comme l’isolement ou la contention. Sur ces derniers points, ça fonctionne plutôt bien. Après, le juge ne peut pas contester l’avis des médecins. Autrement dit, si un médecin dit qu’une hospitalisation est nécessaire, le juge ne peut pas s’y opposer, même s’il a un doute. Du coup, une partie du contrôle lui échappe, et une partie des droits des patients aussi.
Autre difficulté : certains droits pourtant prévus par la loi ne sont presque jamais respectés. Par exemple, les commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP) sont censées vérifier les hospitalisations sans consentement au bout de trois mois, notamment en cas de péril imminent — quand une personne est hospitalisée sans qu’un proche puisse l’accompagner, parce que son état est jugé trop grave. En réalité, ces contrôles sont très rares. D’autres droits sont aussi peu appliqués. Comme celui de consulter un médecin extérieur : prévu par les textes, mais rarement autorisé. Ou celui de se faire soigner dans un autre secteur que celui où l’on habite : possible en théorie, mais très difficile en pratique, car les conditions sont très strictes — il faut généralement prouver qu’une procédure est en cours contre l’hôpital où l’on est soigné.
Plein Espoir : Est-ce que ces limites alimentent une forme de méfiance envers les institutions ?
Raphaël Mayet : En France, on oppose encore trop souvent le droit à la santé aux droits du patient. Une logique contraire à celle défendue par l’OMS, qui promeut une amélioration des soins psychiatriques en renforçant les droits des personnes concernées. Le vrai problème, au fond, c’est l’adhésion. Plus on force, moins les patients s’impliquent. La contrainte peut sembler efficace sur le moment, mais sur le long terme, elle casse la confiance, abîme la relation de soin et éloigne les personnes du système de santé.
Il existe pourtant d’autres chemins, encore trop peu explorés. Des approches qui demandent de repenser en profondeur notre façon de voir la santé mentale. Non pas seulement à l’échelle locale, mais à l’échelle nationale, avec une vraie politique d’ensemble, qui place enfin la personne au centre — non plus comme un simple patient, mais comme un sujet de droits.
Plein Espoir : Vous évoquez d’autres chemins possibles, de quoi parlez-vous concrètement ?
Raphaël Mayet : D’abord, il faudrait harmoniser les pratiques sur le territoire. Car même si la loi est la même partout en France, son application peut être très différente d’un hôpital à l’autre. Dans un établissement, un patient sera hospitalisé sous contrainte pour un certain comportement ; dans un autre, ce même comportement ne donnera lieu à aucune mesure. Pourquoi ? Parce que les décisions dépendent beaucoup des habitudes locales, de la culture du service, de la façon dont les soignants et les juges interprètent le texte. La jurisprudence, c’est-à-dire les décisions rendues par les tribunaux, devrait permettre de clarifier les règles, de créer des repères. Mais aujourd’hui, elle reste floue. Du coup, ça renforce les différences entre les territoires.
Ensuite, je pense à la pair-aidance, par exemple, ou à des formes alternatives d’accompagnement comme les habitats collectifs pour personnes en situation de handicap psychique. Ce sont des lieux de vie où l’on recrée du lien, de la stabilité, et où l’on évite bien souvent les hospitalisations sous contrainte. Prenez la Maison Perchée. L’un de ses animateurs racontait son parcours : avant, c’étaient des allers-retours incessants à l’hôpital. Depuis qu’il vit là-bas, il n’a plus jamais été hospitalisé. Ce témoignage n’est pas isolé. Et il montre ce que peuvent apporter, au quotidien, le soutien des pairs et des lieux ancrés dans la vie réelle, qui redonnent de l’autonomie aux personnes — et leur offrent une autre voie que celle de la contrainte.
Plein Espoir : Ces initiatives qui placent le patient au cœur du soin restent encore trop rares. Et puisqu’on parle des droits des patients, que pensez-vous des inégalités d’accès aux spécialistes selon les territoires ?
Raphaël Mayet : Aujourd’hui, beaucoup de personnes n’ont même plus de médecin traitant. L’hospitalisation sans consentement devient parfois une solution par défaut, simplement parce qu’aucune prise en charge n’a pu être mise en place en amont. Il y a trente ans, presque tout le monde avait un généraliste, un médecin de famille, un point d’ancrage. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Et la situation est encore plus difficile en psychiatrie. Dans certains départements, il n’y a plus un seul psychiatre en libéral. C’est une réalité, il y a une inégalité d’accès aux soins psychiatriques. Il faut dire que la psychiatrie attire de moins en moins les jeunes médecins. Spécialité mal reconnue, conditions de travail difficiles, manque de moyens : rien n’encourage à s’y engager. Résultat, ce sont des territoires entiers qui se retrouvent sans offre de soins, ou avec des délais d’attente interminables.
Pourtant, des solutions existent. Comme les directives anticipées en psychiatrie. C’est un document que l’on rédige quand on va bien, pour dire ce que l’on souhaite — ou refuse — si l’on va mal. On peut y noter les traitements que l’on accepte, les proches que l’on veut voir appelés, les gestes que l’on redoute, les signes annonciateurs d’une crise. Cela permet d’anticiper, de garder la main sur ce qui pourrait arriver. Les études ont montré qu’elles permettent de réduire d’un tiers les hospitalisations sans consentement. C’est considérable. Parce qu’un soin préparé est souvent un soin mieux accepté. Il est urgent de les généraliser. Pour que les soins ne soient plus subis mais pensés.
Plein Espoir : En France, les patients peuvent rédiger des directives anticipées en psychiatrie, mais les médecins ne sont pas obligés de les respecter. Est-ce qu’il faudrait aller plus loin ?
Raphaël Mayet : Oui ! Aujourd’hui, les directives anticipées en psychiatrie n’ont pas de réel cadre légal. Elles existent, mais rien n’oblige les médecins à les suivre. Résultat : elles peuvent être contournées, parfois même ignorées. Et tant qu’on restera dans ce flou juridique, elles auront peu de poids dans les pratiques. Ce que je défends, c’est une autre logique : les soins sans consentement ne devraient être envisagés qu’en dernier recours, une fois que les directives anticipées ont été essayées et qu’elles ont échoué. C’est tout le système qu’il faut inverser.
On pourrait s’inspirer d’un outil qui existe déjà : le mandat de protection future. Il permet à une personne, tant qu’elle est encore en pleine possession de ses moyens, de désigner quelqu’un de confiance pour la représenter si un jour elle n’est plus en état de décider. Ce mandat concerne la gestion de ses biens, sa vie quotidienne, et même ses soins. Pourquoi ne pas appliquer cette logique à la santé mentale ? Les directives anticipées pourraient devenir une forme de mandat spécifique : une personne, en période de stabilité, pourrait y inscrire ce qu’elle souhaite ou refuse. Elle pourrait préciser les traitements acceptés, ceux qu’elle rejette, et désigner une personne de confiance pour porter sa parole quand elle ne peut plus le faire elle-même. Ce serait une manière concrète de faire respecter sa volonté, d’organiser les soins à l’avance, plutôt que de les subir dans l’urgence.
Plein Espoir : Quand on voit qu’il manque déjà de soignants ou même simplement de temps pour écouter les patients, comment imaginer un changement de modèle ?
Raphaël Mayet : C’est évident qu’il y a un manque de moyens, après, on dit souvent que la psychiatrie va mal parce qu’on a fermé trop de lits. Mais parfois, fermer des lits, ça peut aussi être une bonne chose — à condition de réutiliser les moyens autrement. Un lit d’hôpital coûte très cher, jusqu’à 900 euros par jour. Si on utilisait cet argent pour créer des équipes mobiles, disponibles 24h/24, capables d’intervenir à domicile, on pourrait accompagner les personnes plus tôt, avant que la situation ne se dégrade.
Il ne faut pas attendre qu’une personne soit déjà affaiblie, isolée pour intervenir. Le soin devrait commencer bien avant. C’est pour ça qu’on ne peut plus opposer soin et droits des patients. Le droit à la santé, c’est d’abord le droit d’être aidé à temps, par des professionnels accessibles, à l’écoute. Soigner, c’est aussi prévenir, soutenir, être présent.
Plein Espoir : Est-ce que vous restez confiant pour la suite ? Vous voyez des raisons d’espérer, des signes de changement possibles ?
Raphaël Mayet : Comme je le disais, ces dernières années, on a vu une amélioration des droits des patients. Elle reste partielle, encore inégale, mais elle va dans le bon sens. Cela dit, je ne serai vraiment optimiste que si l’on repense en profondeur tout le cadre psychiatrique. Tant qu’on se contentera de réformes ponctuelles, sans vision d’ensemble, tant que des instances clés comme les commissions départementales des soins psychiatriques restent marginales, on ne fera que colmater.
Ce qui est difficile à accepter, c’est qu’on avait annoncé que 2025 serait l’année de la santé mentale. Un temps fort, une promesse politique portée par l’ancien Premier ministre, avec un engagement personnel, familial même. Il avait fixé une feuille de route. Mais il est parti avant la fin de l’année. Et depuis, on ne sait plus très bien ce qu’il reste de cette ambition.