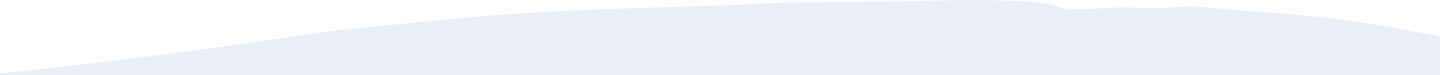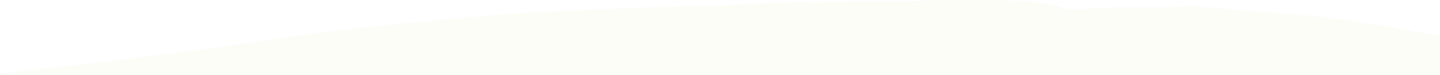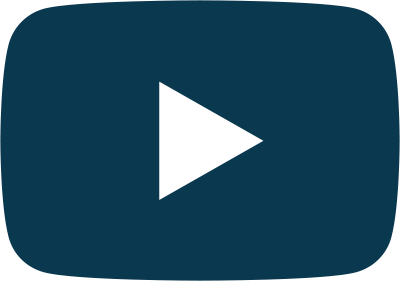Troubles psychiques et parentalité : accompagner le rétablissement de son enfant à son rythme
Quand on devient parent, on imagine un chemin pour son enfant. On souhaite qu’il ne manque de rien, bien sûr, mais surtout qu’il apprenne à faire seul, à tracer sa voie dans un monde qu’on sait parfois difficile. Mais il arrive que les troubles psychiques viennent bouleverser l’équation. Tout semble aller bien, et soudain, sortir de sa chambre, se laver, prendre un bus deviennent des épreuves. Et face à cela, on s’inquiète, on s’épuise, on s’agace aussi. Il faut alors apprendre à voir les choses autrement. À ne plus regarder son enfant à travers ce qu’il devrait faire, mais à travers ce qu’il essaie, à son rythme. Valérie et Nadia ont accepté de nous raconter le chemin parcouru avec leurs filles, Audrey et Sarah. L’une vit avec un trouble anxieux généralisé, l’autre avec un trouble du spectre de l’autisme. Deux histoires pleines de doutes, d’ajustements et de petits pas qui finissent par compter.
Être parent, c’est souvent projeter un parcours fantasmé sur son enfant, sans même s’en rendre compte. On imagine nos enfants débrouillards, entourés, pleins d’envies. On croit, à tort, qu’un amour immense suffira à les mettre à l’abri, à les protéger de tout. Alors on trace dans sa tête une ligne droite, pavée d’étapes rassurantes : des copains, le bac, des trajets en autonomie, un premier job, peut-être. On se dit que ça viendra, naturellement. Que c’est comme ça que ça doit se passer. Mais parfois, le scénario déraille. Il faut alors apprendre à marcher à petits pas, rester liés, même quand il faut accepter de renoncer à certaines choses.
Quand les gestes les plus simples deviennent des sommets à gravir
Valérie se souvient de l’enfance d’Audrey comme d’un grand ciel bleu. Une petite fille vive, bavarde, le rire facile, le regard toujours tourné vers les autres. À l’école, tout se passe bien. Elle aime apprendre, elle est entourée. Adolescente, elle sort beaucoup, elle vit fort. Bien sûr, il y a déjà quelques ombres, mais c’est normal à cet âge-là. Audrey a toujours eu peur de la maladie. Par exemple, dès qu’un camarade vomit, elle s’enfuit. Pour elle, c’est la pire chose au monde, une panique incontrôlable. Et puis, elle n’aime pas trop le changement. Il suffit de changer de place un meuble dans sa chambre pour qu’elle perde le sommeil. Elle a besoin de cadres, d’être sûre que les gens l’aiment, qu’ils ne vont pas partir.
À dix-huit ans, elle tombe enceinte. Un oubli de pilule, comme si elle ne mesurait pas encore que son corps est devenu celui d’une femme. Pour Valérie, le choc est double. Une semaine plus tôt, elle a appris qu’elle avait un cancer du sein. C’est trop d’informations en même temps. Alors elle fait un choix qu’elle traîne encore avec elle : elle part quelques jours de la maison, laisse son mari s’occuper de sa fille. « J’étais vidée, lessivée… J’avais l’impression que tout s’effondrait en même temps, mon corps, ma fille, nos repères. J’ai fui. C’est dur à dire, mais c’est ce que j’ai fait. »
Après cet événement, tout semble reprendre sa place. Audrey poursuit ses études. Mais un an plus tard, le jour anniversaire de l’avortement, la jeune femme fait une crise de panique dans le métro. Elle est en sueur, son cœur s’emballe, elle a l’impression qu’elle va mourir. Par chance, une amie la ramène chez elle. À partir de ce jour-là, tout change. Dès qu’elle sort de son lit, ses mains tremblent. Son cœur cogne trop fort. Elle n’arrive pas à expliquer ce qui lui arrive, et Valérie, elle, ne sait plus comment l’aider. « Elle, qui était si libre, si pleine d’élan, ne savait même plus comment se lever. Je ne comprenais pas. C’est pourtant pas si difficile de se lever, je l’ai fait quand j’étais malade. Au début, je pensais que c’était une mauvaise passe. Mais ça ne passait pas. » Pour la mère de famille, c’est comme si un voile était tombé sur sa fille. Un voile dont elle ne connaissait ni la texture, ni les bords. Au bout de quelques mois, le psychiatre qui suit Audrey parle de trouble anxieux généralisé.

Une petite fille différente qui cumule les troubles
Pour Nadia, l’histoire est différente. Elle a longtemps pensé que sa fille était originale. Une petite fille pleine d’imagination, avec ses obsessions passagères et ses peurs minuscules. Un jour, c’était les papillons. Le lendemain, les fourmis. En famille, on en riait tendrement. « Sarah est fofolle », disait-on, comme une façon de ne pas s’inquiéter. Mais Nadia, elle, sentait bien qu’il y avait quelque chose. Sa fille était maladroite, certaines choses lui semblaient impossibles. Les lacets, les ciseaux, le coloriage. Elle découpait toujours de travers, dessinait comme elle pouvait. Elle avait du mal à situer son corps, à se repérer dans l’espace. Avec le temps, un mot a fini par mettre un nom sur ce flou : dyspraxie. Et puis un autre : dysgraphie.
À l’école, les jeux de balles étaient un cauchemar. Elle n’attrapait rien, n’envoyait rien. Écrire lui faisait mal. Sarah serrait son stylo trop fort. « Un jour, en CP, elle avait mal découpé un exercice. Je croyais qu’elle s’en fichait. Je lui ai demandé de recommencer. Mais elle n’y arrivait pas. Et moi, je croyais qu’elle faisait exprès. » Il y a aussi eu les devoirs, les cahiers. À cause de la dysgraphie, son écriture était tremblante, désordonnée. Nadia déchirait les feuilles, pensant que ce n’était pas assez soigné. « Je voulais l’aider à progresser… mais avec le recul, je vois que je l’épuisais. » Le collège est arrivé. Avec lui, l’anxiété. Sarah parlait très vite, trop vite. On ne la comprenait pas toujours. Alors Nadia l’a amené voir une orthophoniste qui leur a expliqué que ça pouvait être lié à la dysgraphie. Quelques mois après sa rentrée en sixième, une prof lui reproche d’avoir mal colorié une carte de géographie. Elle lui dit qu’elle n’a pas fait d’effort. Alors, les fois suivantes, l’adolescente demande à son petit frère de le faire à sa place. Sarah se sent nulle. Inadaptée.
Un jour, un exercice d’alerte attentat a tout fait basculer. Une simple simulation, mais pour elle, un vrai traumatisme. Coincée sous une table, compressée contre les autres, persuadée que c’était réel. Depuis, chaque bruit violent — marteau-piqueur, sirène, portière qui claque — ravive cette peur. Son corps se souvient, comme si l’alerte ne s’était jamais arrêtée. Nadia a cherché de l’aide. Psychologues, thérapies. Mais souvent, on cherchait à éteindre les feux un par un, sans jamais regarder l’ensemble. La maman, elle, voyait bien que quelque chose persistait. Sa fille parlait d’une "batterie sociale" qu’il fallait recharger, seule, après chaque interaction. À la fin du lycée, un nouveau mot vient enfin se poser sur ce que vit Sarah : trouble du spectre de l’autisme (TSA). Une explication, oui — mais aussi tout un monde à réapprendre.

Composer avec l’imprévu, les retours en arrière, avec cette lenteur qu’on n’avait pas choisie
Quand Audrey fait une crise d’angoisse, Valérie fait ce que font tant de mères. Elle prend sa fille dans ses bras, lui murmure que ça va passer, que ce n’est qu’une mauvaise période. Elle veut y croire. Mais au fond, une inquiétude grandit. Quand les jours passent, puis les semaines, sans amélioration, cette inquiétude devient vertige. Audrey a mis ses études entre parenthèses, incapable même de descendre seule au coin de la rue. « Je voulais l’aider, mais je ne savais plus comment. Elle avait peur de tout, tout le temps. Je me disais qu’elle avait besoin d’un cadre, d’un lieu où on saurait faire mieux que moi. Et c’est vrai que j’arrive plus vraiment à la regarder comme avant. Elle était si différente » Les crises d’angoisse d’Audrey sont quotidiennes. Les médicaments, prescrits à la va-vite, ne l’apaisent que brièvement. Valérie fait de son mieux, mais elle perd patience. Parfois, elle s’énerve. « Je me disais : ce n’est pas possible, elle va finir folle… Et je n’arrivais même pas à dire ce mot sans culpabilité. » Le lien entre elles devient fragile, tendu, tissé d’amour et d’impuissance.
Alors,Valérie décide de reprendre les choses en main. Pas de manière brutale, non. Mais avec une méthode, une stratégie maison, bricolée à l’intuition : fixer des objectifs, même minuscules. « Si tu vas jusque-là, il se passera ça. Tu auras droit à ça. » Une façon d’ancrer le progrès dans quelque chose de positif. « J’ai compris qu’elle avait besoin d’un cadre, mais surtout d’un horizon. Juste un petit plaisir au bout de l’effort. » Audrey joue le jeu. Elle avance à pas minuscules, parfois en arrière, parfois sur le côté. Et un jour, elle réussit. Trois stations de métro. Seule. Le cœur tambourine, les mains tremblent, mais elle tient.
Valérie retient ses larmes. « J’avais l’impression qu’elle venait de gravir l’Everest. Pour moi, c’était immense. » Ce petit exploit change la dynamique. Audrey retrouve un peu d’élan, un peu de confiance. L’idée de reprendre le chemin de l’école ne semble plus si lointaine. Elle n’est pas guérie, non. Mais elle n’est plus figée. Et ça, c’est déjà beaucoup.
Des stratégies pour avancer ensemble
Quand le diagnostic de trouble du spectre autistique est tombé, Nadia s’attendait à des larmes, peut-être même à de la colère. Mais au fond, sa fille savait. « Mettre un mot, c’est parfois arrêter de se sentir décalée sans raison. Quand on comprend enfin ce qui se passe, on peut chercher des solutions. » Et c’est ce qu’elles ont fait, toutes les deux. Trouver des systèmes, des astuces, des façons de rendre le quotidien plus facile.
Pour la douche, par exemple. Sarah pouvait y rester quarante minutes, sans s’en rendre compte. Elle se perdait dans ses pensées, dans la sensation de l’eau. Alors une idée a émergé : les chansons. Une chanson pour une douche rapide. Deux ou trois si elle doit se laver les cheveux. Elle met sa playlist, et le temps s'organise tout seul. « Avec la musique, elle sait où elle en est. Et nous aussi. »
Même en études supérieures, le stress des devoirs reste une zone sensible. Le lundi soir, surtout, quand tout s’accumule. Alors Nadia s’assoit encore parfois à côté d’elle. Ensemble, elles listent, hiérarchisent, découpent la semaine. « Une fois que tout était posé, elle respire mieux. Elle a besoin de savoir, de visualiser. C’est sa façon à elle de reprendre la main. » Rien n’est simple, mais rien n’est figé non plus. Chaque solution trouvée ressemble à une petite victoire. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Les jours de fatigue, de surcharge ou d’anxiété diffuse, c’est comme si tout s’effondrait d’un coup. Comme un grand retour en arrière, imprévisible et décourageant. Pour Nadia, ces moments-là sont les plus durs. Elle a l’impression d’avoir tout mal fait, de ne pas savoir comment l’aider. « Je me dis que je m’y suis mal prise… que j’ai raté quelque chose. »
Comprendre que grandir, c’est parfois apprendre à faire moins, mais mieux
Aujourd’hui, Audrey a terminé ses études. Elle travaille dans le service communication d’une association. Elle a quitté la maison, doucement, par étapes. Elle vit à quelques rues seulement de chez ses parents. Comme un entre-deux rassurant. « Comme ça, si ça ne va pas bien, elle peut venir. Elle sait qu’on n’est jamais loin. »
Tout n’est pas parfait, bien sûr. Audrey a choisi un travail proche, pour éviter les transports. Elle ne sort jamais sans son médicament au fond du sac, comme un filet de sécurité. Elle ne prend pas l’avion, renonce parfois à certaines escapades, certains projets. Mais elle vit. Presque comme les autres filles de son âge. Et ça, Valérie le vit comme une victoire. Elles ont gardé un réflexe, toutes les deux : célébrer chaque petite avancée. Un repas, une attention, un mot doux. Parce que rien ne va de soi, et que tout progrès mérite d’être vu, nommé, partagé.
Valérie aurait voulu que sa fille ne perde pas de temps, qu’elle profite davantage de ses vingt ans. « Parfois, je suis triste qu’elle ait été obligée de passer par là, mais c’est une super femme et je suis très fière d’elle. » Ces épreuves, elles ne les ont pas seulement traversées. Elles les ont partagées. Et dans les creux, dans les silences, dans les tâtonnements, un lien s’est renforcé. Plus solide. Plus doux, aussi.
De son côté, Sarah est en deuxième année de licence. Elle aime ce qu’elle fait, elle s’y sent bien. Ses journées sont rythmées par des rituels qu’elle a elle-même construits. Dans l’autisme, ces routines ne sont pas des détails : elles organisent le monde, le rendent un peu plus prévisible. Sarah a ses propres repères, ses stratégies et Nadia les respecte.
Comme le diagnostic est arrivé tard, Nadia et son compagnon ont longtemps insisté pour que leur fille “fasse comme les autres”. Qu’elle tienne bon, qu’elle dépasse ses blocages. Même après que le mot ait été posé, ils n’ont pas relâché l’effort. « Quand elle est partie faire un stage à l’étranger, elle a failli rentrer au bout de quelques jours. Elle était en panique. Elle voulait tout arrêter. Je lui ai dit : si tu ne tiens pas ces trois mois, il faudra peut-être repenser tout ton projet professionnel. » Sarah a tenu. Il a fallu du temps, des ajustements, beaucoup de solitude. Mais elle est restée. Et elle est rentrée changée. Fière d’elle. « Ce n’était pas parfait, mais elle l’a fait. Et maintenant elle sait qu’elle en est capable. »
Aujourd’hui, Nadia regarde sa fille avancer autrement. Avec plus de conscience, plus d’autonomie. Elle a appris à lâcher prise. Certaines choses prendront du temps. D’autres ne viendront peut-être jamais. « Ce n’est pas grave. On fait avec. De toute façon, personne ne sait tout faire. »
Des stratégies pour avancer ensemble
Au début, Valérie et Nadia ont cherché des explications. Elles ont voulu comprendre, corriger, accélérer. Elles ont espéré que ce n’était qu’un détour, qu’un pli passager dans l’histoire de leurs filles. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Il a fallu du temps pour nommer les choses, et encore plus pour les accepter. Pour cesser de vouloir réparer. Pour apprendre à faire avec. Peu à peu, les deux mamans ont changé de posture. Elles ont compris qu’il ne s’agissait pas de tirer, mais d’ajuster. D’apprendre à accompagner autrement. Ça ne s’est pas fait en un jour. Il a fallu de la patience. Et des renoncements, aussi.
Audrey et Sarah avancent à leur rythme. Avec des limites, des stratégies, des jours sans. Et malgré tout, une force tranquille. Valérie et Nadia, elles, ont appris à rester à leurs côtés. Présentes sans brusquer. À aimer sans conditions. Ce qu’elles ont gagné en chemin — la confiance, la complicité, ce lien tissé au fil des épreuves — vaut peut-être plus encore que ce qu’elles avaient imaginé.
Vous souhaitez en savoir plus et rencontrer d’autres personnes engagées dans le rétablissement ? Rejoignez les réseaux sociaux de Plein Espoir, le média participatif dédié au rétablissement, créé par et pour les personnes vivant avec un trouble psychique.
Cet espace inclusif est une initiative collaborative ouverte à toutes et tous : personnes concernées, proches, et professionnels de l’accompagnement. Vos idées, témoignages, et propositions sont les bienvenus pour enrichir cette aventure. Contribuons ensemble à bâtir une société plus éclairée et inclusive.